
 Le texte ci-aprés vous est proposé par le
Le texte ci-aprés vous est proposé par le
Docteur Sylvie Kandé
Ecrivaine et enseignante
State University of New York-Old Westbury
La Raparille par Fadel Dia. Paris: Présence Africaine, 2009
En matière de construction identitaire, le cas des signares est, mutatis mutandis, non moins troublant que celui de Michael Jackson. Comme on le sait, les signares --nhara en Guinée portugaise et senora en Gambie—étaient des Africaines associées au personnel administratif et militaire des établissements coloniaux européens sur la côte guinéenne ou sénégambienne, ainsi qu’à des commerçants privés de la même origine. Ces alliances, souvent scellées par un “mariage à la mode du pays”-- une institution probablement en existence depuis le 15ème siècle-- sont abondamment documentées pour le 18ème et 19ème siècles. Elles profitaient aux Européens qui pouvaient ainsi étendre leurs réseaux commerciaux dans l’arrière-pays, bénéficier d’une meilleure hygiène de vie et négocier les obstacles linguistiques et culturels qu’ils rencontraient; mais aussi aux signares qui avaient dès lors accès aux magasins du comptoir, voyaient leur statut et celui de leurs enfants s’élever et leur fortune se matérialiser sous la forme de maisons “en dur”. Il reste que leur fonds de commerce, comme celui de bien d’autres traitants africains de l’époque, était en partie constitué d’esclaves vendus aux navires négriers en partance pour les Amériques – aussi longtemps en tous cas qu’il leur fut possible de les écouler1. La Signare, qui compte au nombre des mythes fondateurs de la culture politique sénégalaise, représente une version généralement dédramatisée, voire romantisée, de l’histoire coloniale. Elle figure en bonne place dans les Esquisses Sénégalaises de l’Abbé Boilat (1853), comme dans l’oeuvre poétique et philosophique senghorienne dont elle constitue en quelque sorte la croisée d’ogives. Elle est encore au coeur du dernier roman de Fadel Dia, La Raparille (2009). Ce texte, quoiqu’en évidente conversation avec deux autres romans d’auteurs sénégalais, Nini d’Abdoulaye Sadji (1954) et Signare Anna ou le Voyage aux escales de Tita Mandeleau (1991), s’en distingue par sa problématique. Notons d’abord que thématiquement, La Raparille est dans le droit fil de deux ouvrages sur Saint-Louis du Sénégal précédemment publiés par l’auteur, historien et géographe de formation et ancien enseignant-formateur à l’Ecole Normale Supérieure de Dakar. C’est aussi le second texte de fiction2 de Fadel Dia, qui, comme un certain nombre de ses collègues historiens, a franchi les frontières de sa discipline pour s’essayer au roman historique3. Il le fait avec talent et bon goût. La Raparille est composé d’une série d’entretiens qu’une signare saint-louisienne âgée, Toinette Bouton, a avec, tour à tour, son notaire, Maître Alphée Sarrasin, le jeune commis français de ce dernier (un dénommé Roméo Vignole qui fonctionne aussi comme narrateur dans le récit), un griot réputé, Sally Seck, d’autres signares, le Docteur St-Jean ainsi que le Lieutenant Bauer, commandant du camp de l’Artillerie. Ces conversations entraînent le lecteur dans un passé dédoublé --à savoir un passé “antérieur” qui établit la généalogie de Toinette, les circonstances de ses mariages successifs et les sources de sa fortune; et un passé contemporain de la crise qui porte le coup de grâce à ce personnage. Toinette veut en effet léguer son bien à Cathy, sa fille adoptive, la dite Raparille --un projet en soi incongru dans son cercle, puisque “rapar(e)illes” et “rapaces” étaient des esclaves domestiques; de surcroît, la capture fortuite de Famadu, un leader de l’arrière-pays en rebellion contre l’avancée coloniale, suivie de son internement à Saint-Louis viennent éclairer le mystère de la naissance de Cathy et par ricochet, frustrer Toinette d’héritière. Ainsi doté d’un narrateur homodiégétique double (Toinette et Vignole) le roman couvre une période historique relativement large et aisée à définir, bien que le texte soit à dessein dépourvu de dates. On apprend par exemple que le père de Toinette, Paulin Jeaume, né sur une plantation guadeloupéenne, débarque à Saint-Louis avec une compagnie d’engagés antillais (p. 32-35) -- c’est-à-dire en 1799. Il y est compromis dans l’insurrection contre le gouverneur Lasserre (p. 60) qui, comme on le sait, fut déposé en 1802 par les “Habitants” alors qu’il prétendait leur imposer un impôt proportionnel au nombre de leurs captifs. Revenu à Saint-Louis pendant l’occupation anglaise, Paulin participe si activement à la tentative de sauvetage de la frégate La Méduse (1816) qu’il reconquiert le droit de résidence sous le nouveau gouverneur français (Julien Schmaltz). En outre, une esquisse de la jeune Toinette en pensionnaire chez les religieuses nous la montre lisant un ouvrage alors en vogue, La Chaumière africaine (p. 10). Or, ce “premier roman saint-louisien”, écrit par Adelaide Picard —l’épouse de l’instituteur français Jean Dard, lui-même auteur de la première grammaire et du premier dictionnaire wolof4— parut en 1824. Dans La Raparille, il est encore question de la Banque du Sénégal, une institution créée en 1853, ainsi que de l’École des Otages, fondée en 1855. Les propos d’un commis de Toinette relatifs à l’exportation récente de 30 000 tonnes d’arachides du Sénégal (p. 47) évoquent la fin des années 1870, puisque de 8 772 tonnes d’arachides exportées en 1870 on passe à 45 061 tonnes en 1885, selon les chiffres de Boubacar Barry qui lie encore le boom de la production arachidière au développement du port de Dakar et du chemin de fer Dakar-Saint-Louis5. Dans le roman, mention est effectivement faite de la rivalité en germe entre les deux villes (p. 166) ainsi que des travaux ferroviaires en cours (p. 47) – ce qui laisse à penser que Toinette décède quelque temps avant l’inauguration de la ligne Dakar-Saint-Louis en 1885. Embrassant donc plus d’un siècle d’événements historiques et fictifs (depuis le milieu du 18ème siècle jusqu’aux années 1880), le roman s’intéresse aussi à une vaste aire géographique. Si les souvenirs personnels de Toinette font traverser au lecteur les quartiers de Saint-Louis et la région environnante, des escales jusqu’au pays de Galam dans le Haut-Fleuve en passant par l’île de Tieng, ses rêves par contre, la mènent en France et c’est l’impression de la culture française qu’elle a formée à distance qui souvent la guide dans ses jugements esthétiques (p. 20). Bien sûr, Saint- Louis reste la référence centrale du roman, de même que la maison de Toinette, tout à la fois synecdoque de la ville et panopticon, sert de lieu principal d’énonciation. La diversité des personnages qui y gravitent reflète d’ailleurs le cosmopolitisme de la communauté saint-louisienne et l’attribution d’aieux paternels antillais à la signare rappelle la position cruciale de Saint-Louis sur la carte de la Diaspora6. Ville du Retour, le Saint-Louis de La Raparille se fait ainsi le théâtre de drames qui illustrent la complexité des rapports humains définis par des systèmes esclavagistes imbriqués. Ainsi Paulin Jeaume, fils d’une esclave “ ‘libre de savane’, c’est-à-dire libre d’aller où elle voulait, pratiquement affranchie” (p. 23), devenu marron en Guadeloupe par peur d’être vendu, cherche à gagner Haiti qui vient de se soulever contre l’ordre plantationnaire, est mis à fond de cale par les Anglais, puis restitué aux Francais qui envoient cet engagé à Saint-Louis comme exemple “du niveau de développement [auquel] se sont hissés les fils du continent noir qui ont été mêlés aux modes d’existence inspirés par l’Europe” (p. 64) – autrement dit pour promouvoir l’idée d’abolition de l’esclavage dans une région qui y était réfractaire. Or, Paulin se met à “trafiquer” et à l’Escale du Coq, acquiert une esclave –prétendûment pour lui épargner une mort certaine au cours du voyage transatlantique. Lui qui tenait tant à se débarrasser du nom qui lui avait été imposé à la naissance par son propriétaire et père putatif, Clément Jeaume, laisse baptiser cette enfant d’un nom grotesque suggéré par d’autres marchands (“Appelez-la donc Marie!.... Cela porte chance de commencer par le nom de la mère du Christ !... Alors ce sera Marie-Escale!... Un esclave c’est comme un galet que l’on sème sur son chemin: il doit vous rappeler un lieu, un événement de votre existence” (p. 37-38)). A la blessure du nom s’ajoutera pour Marie-Escale celle d’un mariage forcé (p. 135-136), puisque Paulin, dans la plus pure tradition patriarcale, la fait élever dans le but de l’épouser. Remarquons que Toinette, entourée de domestiques qu’elle appelle Doucement, Fanal et Joli-Coeur, perpétue cette tradition du “nom de la honte”7. Certes, pour faire bon poids bonne mesure, elle affublera également l’un de ses époux du nom d’Albis, mais, avec le recul du temps, semble vouloir justifier davantage la contraction du “terme barbare” d’albinos que de sa manie de la dénomination mortifiante: “Nous vivions dans un monde de sobriquets !” avance-t-elle. De fait, c’est la facticité de son milieu plus que les rouages économiques et idéologiques du signarat qu’elle dénonce (p. 43 & 156-157). Narré à deux voix -- l’une masculine et relativement effacée, celle de Vignole, l’autre féminine et souvent péremptoire, celle de Toinette -- La Raparille est construit autour d’une figure féminine-janus, Toinette et Cathy se faisant pendant. Le personnage éponyme du roman, Cathy, la Raparille, reste énigmatique et fuyant: son portrait, qui n’apparaît qu’à l’avant-dernier chapitre, révèle sa jeunesse, son indépendance et son intégration partielle au milieu signare. Quant aux motifs de sa poursuite incessante des prisonniers venus de l’arrière-pays, ils ne s’éclairent que dans les dernières pages du récit, ce qui contribue également à ménager le suspense nécessaire au genre. Toinette, au contraire, confie très librement son histoire, celle d’une ascension sociale. Elle a survécu à une épidémie de fièvre jaune et de choléra, grâce à une existence de rechange pour ainsi dire (p. 189). Elle a tiré de mariages, somme toute réussis, l’expérience et le capital nécessaires pour bâtir son propre fief et règner sur un “gynécée”. Dès lors, comment comprendre cette décision singulière de faire de Cathy, une prise de guerre, sa seule héritière ? Les ravages du temps sur le corps de Toinette, crûment et répétitivement décrits (pp. 43, 112, 184), s’interprètent sans mal comme les signes du déclin du signarat – un processus historiquement amorcé avec l’abolition française de l’esclavage en 18488 et la fin de la mairie Durand-Valantin9. Quant à son absence de descendance, Toinette la met au compte d’un destin personnel, rejetant violemment les thèses du racisme scientifique de l’époque, et notamment celles du Dr Bérenger-Féraud (p. 15), auteur des Peuplades de la Sénégambie (1879), selon lequel les “mulâtres” seraient invariablement stériles à la quatrième génération. On note qu’elle évite cependant d’entrer dans le débat sur le rôle politique des dits mulâtres dans le projet colonial: en effet, tandis que Bérenger préconisait une stricte séparation des races pour l’exploitation maximale des ressources humaines de la colonie --la stérilité des mulâtres les disqualifiant d’emblée comme cadres du projet et symbolisant à ses yeux leur inanité politique-- Faidherbe, lui, promouvait les mariages à la mode du pays, “y voyant, écrit Biondi, une occasion de renforcer, à l’instar de l’École des Otages, les liens avec les États de l’intérieur et d’accroître une population ‘intermédiaire’ dont le rôle social pouvait être décisif” 10. L’effort de Toinette va plutôt consister à refaçonner sa propre identité en s’inventant une descendance qui consoliderait ses liens à l’arrière-pays (dont sa propre mère, Marie-Escale, était issue) et à qui elle léguerait son héritage financier et culturel, dans l’espoir d’ancrer ses héritiers à Saint-Louis (p. 53). D’où la nécessité pour elle de mener le combat sur deux fronts: d’abord s’assurer que son testament est rédigé en bonne et dûe forme, de sorte que la validité n’en soit pas contestée – une mésaventure qui priva sa mère de l’héritage conjugal; ensuite, faire l’état des lieux de sa généalogie et marier Cathy convenablement. Ses hésitations entre deux options --la marier, selon la tradition signare, avec un Français tel que Vignole, ou bien, en prévision de changements socio-politiques, avec “un de ces jeunes noirs … qui demain, peut-être, seront aux commandes de ce pays ...” (p. 53) -- l’amènent à consulter le griot Sally Seck. Celui-ci suggère alternativement une union avec un notable de l’arrière-pays. Toute à son ubristique projet –configurer sa manière de postérité et souffler sur les braises du signarat --Toinette néglige la quête d’identité personnelle de sa fille adoptive. On pourrait dire, sans trop forcer le trait, qu’à l’eugénisme de la première répond l’atavisme de la seconde. Arrachée à sa famille dès l’enfance, au cours d’une de ces campagnes coloniales de torchades à l’est de Saint-Louis, Cathy Militaire semble garder de ses origines aristocratiques une fierté et une insubordination “innées”. Elle finit par retrouver, l’espace d’un instant, son père, qu’“instinctivement” elle cherchait parmi les prisonniers de guerre convoyés sur Saint-Louis: il n’est autre que le sultan Famadu. Allégorie de la résistance des théocraties musulmanes sénégambiennes au 19ème siècle, ce personnage est composé des traits amalgamés de plusieurs figures historiques, entre autres Amadou Cheikhou (Ba), originaire du Fouta Toro, qui combattit l’armée française pendant plus de dix ans pour être défait en 1875 à la bataille de Samba Sadjo; El Hadj Omar Tall, natif de la même région et membre de la même confrérie Tidjane, qui mourut en 1864 dans une explosion de poudre parfois interprétée comme un suicide; Lat Dior qui s’opposa à la construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis et mourut à la bataille du puits de Dékhélé en 1886; Samori Touré, qui exécuta pour trahison le fils qu’il avait envoyé en France, Dyaoulé Karamogo, et qui lui-même mourut en exil au Gabon en 1900 (p. 169-171). Charriant en quelque sorte toute cette histoire dans ses veines, Cathy répondra donc sans surprise à “l’appel des origines”, une fois son identité recouvrée: “Elle est partie à Galam… Elle est allée rejoindre les siens, elle est partie avec sa famille, celle du chef Famadu…” annonce Doucement à une Toinette effondrée (p. 187). Les liens intertextuels qui unissent La Raparille à Signare Anna sont multiples. Certes, la période reconstituée par Tita Mandeleau est antérieure à celle qu’évoque Fadel Dia: elle correspond aux années 1758-1779, c’est-à-dire à la première occupation anglaise de Saint-Louis. Dans ce roman, une trame référentielle serrée (dates, toponymes, personnages historiques et propos attestés) sous-tend une série d’intrigues sentimentales qui se nouent autour d’Anna ou qu’elle orchestre. La luxuriance joyeuse et didactique de la langue de Mandeleau, qui regorge d’expressions en wolof ou en français relatives aux particularismes locaux, traduites ou complétées par des notes de bas de page, tranche fortement avec la facture classique --sobre et précise à la fois—de l’écriture de Dia qui avoue ailleurs “être plus royaliste que le roi dans la défense du français parlé et écrit,” à l’instar des Sénégalais de sa génération11. Il reste que le roman de Mandeleau tourne autour du même personnage central de signare stérile et vieillissante qui élève à Saint-Louis une fille adoptive dans le cadre de la concession familiale (ici Keur Gerbigny) en vue des meilleures épousailles. Même moment psychologique où l’épanouissement physique de la fille remet la mère en question dans sa propre sexualité: on notera d’ailleurs que si les personnages féminins des romans historiques se divisent généralement en femmes fatales et mères dévouées, Anna et Toinette combinent ces deux archétypes et ont donc à double titre cette “relation forte avec le pouvoir dont elles sont les dépositaires”, pour reprendre l’expression de Brigitte Krulic12. Leur incombe donc la responsabilité de passer le flambeau, ce que Bassirou Dieng, dans son analyse de Signare Anna, appelle le mode matriarcal du récit13. Signare Anna et La Raparille sont, à mon sens, à lire en relation avec Nini d’Abdoulaye Sadji, incontournable roman sénégalais sur le métissage où le signarat est représenté par les personnages d’Hélène et d’Hortense, respectivement grand-mère et tante de l’anti-héroine, Virginie Maerle. Loin de se limiter à l’exploitation d’une thématique commune,Signare Anna et La Raparille relativisent aussi l’essentialisme de l’intention de Sadji --qui déclare en préface vouloir faire “l’éternel portrait de la mulâtresse, qu’elle soit du Sénégal, des Antilles ou des deux Amériques” (p. 7) – et ce, en insistant sur la nécessité d’une contextualisation historique de chaque signare. De la sorte, Nini, publié en 1954 mais traitant du Saint-Louis de la première moitié du vingtième siècle, devient la troisième séquence d’une chaîne de représentations littéraires du signarat parues en ordre chronologique inversé: en effet, une première séquence, Signare Anna, en décrit l’apogée troublée (1758-1779), tandis que La Raparille en évoque les fastes passés et le déclin (1799-1884). Mandeleau et Dia offrent donc à Nini rien moins qu’une généalogie fictionnelle qui complexifie remarquablement ce “type social” voulu par Sadji comme falot et désorienté dans ses choix identitaires –même si cette disorientation est finalement “davantage le produit d’un système que l’expression d’un libre arbitre”, comme le souligne El Hadji Malick Ndiaye14. Ma proposition se vérifie sur la question de l’esclavage -- une des lignes de force qui traversent ces trois textes. A ce sujet, Nini reprend à son compte les termes du discours d’une certain élite africaine, protégée par une administration coloniale soucieuse de ses alliances –raison pour laquelle d’ailleurs l’esclavage a persisté plus longtemps dans les colonies africaines que caribbéennes. A des collègues français qui feignent de s’en choquer, Nini déclare: “En tous cas, nous avons toujours nos esclaves de case qui s’estiment heureux d’être sous notre protection…. Vous voulez donner la liberté à des gens qui ne savent qu’en faire, qui n’en veulent pas… C’est nous qui les baptisons, les envoyons à l’école, les marions et les enterrons quand ils sont morts” (p. 142-143). Sadji introduit alors un développement sur la stratégie sémantique que les métis auraient élaborée pour se démarquer du reste de la population et s’imposer, forts d’une liberté si ancienne qu’elle est inscrite dans la langue, comme interlocuteurs privilégiés des colons: “A Saint-Louis, le mot ‘enfant’ est synonyme du mot ‘esclave’. Pour ne pas perdre le prestige dont elles croient jouir auprès des Européens, les mulâtresses en affublent tout Noir surpris chez elles ou y vivant” (p. 144). Tita Mandeleau, quant à elle, n’hésite pas à mentionner la participation des signares à la traite esclavagiste (voir par exemple p. 31 & 52). Mais dans une perspective féministe, elle nous montre Anna elle aussi prisonnière de l’ordre patriarcal imposé par son époux à Keur Gerbigny et auquel tous, y compris les dits captifs, adhèrent: “A la merci de toute sa tapade”, Anna songe qu’“une Signare était davantage captive de ses esclaves que le contraire!” (p. 150) Et seul le départ annuel de son mari aux escales la soulage temporairement de ses entraves conjugales: “… elle pourrait enfin s’occuper d’elle-même. Elle se sentait curieusement rajeunie, libérée, libre !” (p. 102). Tandis que dans Signare Anna le milieu mulâtre paraît bien ancré dans la culture majoritaire, notamment par le mode de vie, la langue et une dénomination englobante (les “enfants de N’dar”) qui tend à gommer les différences de couleur et, dans une certaine mesure, de classe, dans La Raparille la problématique identitaire est au premier plan. Toinette se plaint de l’isolement qui frappe les “Habitants” de Saint-Louis, “des signares et des métis comme elle,” pris en étau entre deux communautés qui les envient et les méprisent. Seuls les griots “quand ils chant[ent] ses louanges ou lui fabriqu[ent] une généalogie empruntée on ne sait où” réussissent à lui donner un sentiment d’appartenance (p. 50). Elle finit par prendre conscience que son enracinement effectif doit passer par la libération de sa captive – ce dont elle a secrètement pris soin-- et la dotation de cette dernière. Cathy ne serait-elle pas d’ailleurs une parente que sa mère lui enverrait d’outre-tombe ? s’interroge Toinette, en mal d’une ascendance africaine (p. 158). Mais sa tardive initiative pour réformer au niveau de sa maison le rapport marchand entretenu de façon séculaire par l’oligarchie saint-louisienne avec l’arrière-pays et pour renouer avec la branche maternelle est vouée à l’échec. Déjà de nouvelles dynamiques historiques se mettent en place, qui excluent les signares: d’une part, l’intensification de la restructuration coloniale du pays avec notamment l’inauguration de la politique d’assimilation, et d’autre part, la résistance anti-coloniale dont les manifestations armées vont faire place à de nouvelles stratégies, électorales ou encore culturelles et spirituelles. Si l’objet des récits consiste à construire des possibles, Fadel Dia nous incite à penser les velléités proto-nationalistes d’une signare et sa tentative (avortée) d’africanisation. La question de la validité comparée du retour aux sources de Cathy reste évidemment ouverte, d’autant que le roman nous aiguille vers d’autres formes de métissage, moins marqués (en théorie) par le rapport colonial. Ainsi Satin, le nom originel de Cathy, évoquerait-il “la rencontre d’une ville de Chine et d’un chroniqueur arabe” (p. 188), rappelant utilement au lecteur qu’une origine peut toujours en cacher une autre. Avec La Raparille, le genre que Daouda Mar appelle “le roman de la signare ou de la mulâtresse en Afrique”15 s’est enrichi d’un texte d’une grande qualité littéraire. Nini, Signare Anna et La Raparille, trois récits qui se complètent et s’affrontent, témoignent de la vitalité de la littérature sénégalaise. La manière dont le monde a accueilli la nouvelle du décès de Michael Jackson est une autre preuve, s’il en était besoin, de la dimension globale des questions de métissage et d’hybridité en ce début de troisième millénaire. Car si la disparition intempestive du prodigieux artiste afflige, ce qui par-dessus tout émeut, c’est l’effort visiblement torturant, effrené et inachevé de l’individu pour concilier identité rêvée et biographie; legs de l’esclavage dans une société libérale et utopie d’un monde post-racial.
La manière dont le monde a accueilli la nouvelle du décès de Michael Jackson est une autre preuve, s’il en était besoin, de la dimension globale des questions de métissage et d’hybridité en ce début de troisième millénaire. Car si la disparition intempestive du prodigieux artiste afflige, ce qui par-dessus tout émeut, c’est l’effort visiblement torturant, effrené et inachevé de l’individu pour concilier identité rêvée et biographie; legs de l’esclavage dans une société libérale et utopie d’un monde post-racial.
























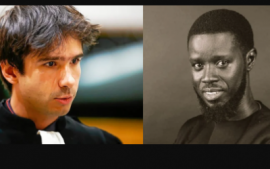








0 Commentaires
Participer à la Discussion